Articles récents
Liens
Activisme Aliénation Anarchisme Andrea Dworkin Anthropologie Antiprogressisme Archéologie Art paléolithique Biocentrisme Biogynophobie Capitalisme Capitalisme vert Charles Macdonald Charles Stepanoff Chasse Civilisation Critique de la civilisation critique de la science Culture masculiniste Domestication Démystification Enfance Francis Dupuis-Déri Féminisme Histoire Identité de genre Imaginaire ITW Littérature Note de lecture Paléolithique Poésie Proféminisme Prostitution Revue Behigorri Rêve Sagesses Incivilisées Techniques de domination Technocritique Technoscience transactivisme Vidéos Violence masculine Écoféminisme Écologie
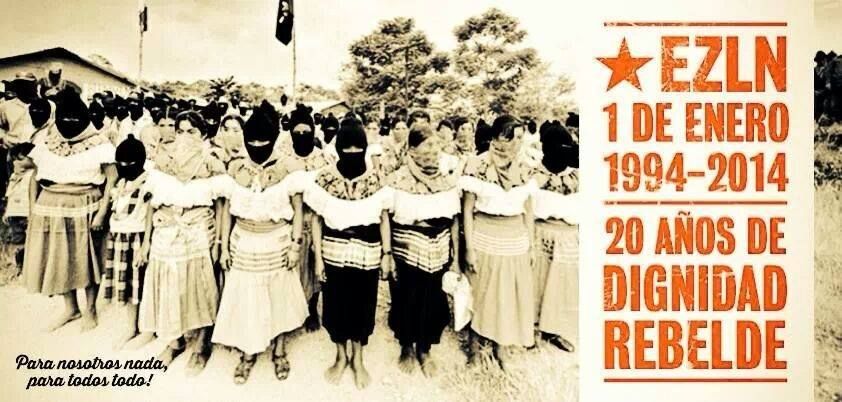
La vision des vaincus, 6 mai 2015 (extrait)
Je vais utiliser des mots légèrement rudes et durs. Je dois dire, pour ma défense, que tous ces mots viennent de compañeras femmes zapatistes non indigènes. Alors, si ça vous scandalise, eh bien, restez bien calés au fond de vos chaises.
[…]
La compañera n’arrêtait pas. Bien sûr, moi, en homme que je suis, j’accusais les coups. Je pensais juste : « Putain de merde, et elle, elle a pas été zapatiste quand elle était petite, alors imagine Defensa Zapatista quand elle grandira. » Bien sûr, je suis un mec, mais pas un enfoiré, je l’ai pensé, mais je n’ai pas pipé mot.
« Ouais t’as raison, quand tu dis que les femmes sont plus cruelles entre elles que les hommes, qu’on utilise des insultes machistes pour se référer à d’autres femmes ; qu’on leur dit “pute”, “fille facile”, “voleuse de mari” ou, comme dans les films de Pedro Infante, “allumeuse”, qui sont d’ailleurs tous des mots que vous, vous avez inventés. Mais c’est pas toi qui dit que tout est un processus ? Que dans les communautés indigènes les femmes ont construit et sont en train de construire leur propre chemin sans que personne ne leur dise comment, ou qu’on leur donne des ordres, ou qu’on leur impose des manuels et des recettes ? Bon, eh ben, nous aussi, on est en train d’apprendre. Et la culture qui nous emmerde à cause de vos conneries nous emmerde jusque dans nos têtes. Et c’est peut-être pour ça qu’il y a autant de féministes que de femmes, car chacun fait à sa façon, et on a chacune notre propre histoire, nos fantômes, nos terreurs et on cherche comment les combattre et les vaincre.
Et vous, face à notre lutte, vous pouvez être d’accord ou pas. Mais j’ai bien dit “face à notre lutte”. C’est-à-dire que vous en faites pas partie de notre lutte.
Aussi sensibles et réceptifs que vous soyez, vous ne pouvez pas être féministes, car vous ne pourrez jamais vous mettre de notre côté, vous n’aurez jamais vos règles, vous n’allez jamais désirer ou avoir peur d’être enceinte, vous n’allez jamais accoucher, vous ne souffrirez jamais de la ménopause, vous n’aurez jamais peur de sortir dans la rue en plein jour, de passer devant un groupe d’hommes, vous n’allez jamais naître, grandir, vivre avec la peur venant simplement du fait d’être ce que l’on est. Et ce n’est pas qu’on ne veuille pas être femmes, et qu’on maudisse le fait d’être nées femmes et qu’on aurait préféré être des hommes. Non, ce qu’on veut, et c’est pour ça qu’on lutte, c’est pouvoir être femme sans que ce soit un péché, une faute, une marque, quelque chose qui nous prédestine à être toujours sur la défensive ou à être des victimes directes. Alors, ne venez pas me parler d’hommes féministes. Il y a des hommes moins pires que d’autres, mais pas des féministes. Quand ces hommes me ramèneront une serviette hygiénique tachée de sang menstruel, alors ouais on pourra parler, et encore… »
Pendant ce temps, j’ai regardé avec attention le corps de la compañera. Non, je ne regardais pas ses fesses ou ses seins. Je regardais ses bras, ses jambes et quel type de chaussures elle portait. Je calculais la portée d’une frappe ou d’un coup de pied. Le calcul fut vertigineux si bien que je me suis éloigné à une distance raisonnable. Elle était furieuse.
La compañera avait des larmes aux yeux, mais pas les larmes d’une victime. C’était des larmes de colère, de rage. La compañera ne prit même pas de mouchoir, elle a nettoyé ses larmes avec sa manche et a continué :
« Oui, je sais ce que tu vas me dire que c’est la faute du putain de système capitaliste. Mais aussi enfoirés de vous qui ne faites rien, qui vous laissez faire. Vous êtes là avec votre truc, comme quoi c’est très important de lutter contre le système, alors que, vous aussi, vous êtes ce sale système. Vous et nous aussi. Mais nous, on ne se laisse pas faire, nous, au moins, on résiste. Vous, même pas, par fainéantise et intérêt, parce que vous êtes des enculés. Et oui, je sais que ça c’est une insulte machiste, mais vous la détestez et c’est pour ça que je l’utilise. Écoute, je vais te dire un truc : l’essentiel, ce sont nos compañeras des communautés zapatistes qui nous l’ont appris. Car nous aussi, parfois, on peut être des enculées en pensant qu’on est meilleures ou qu’on en sait plus ou qu’on n’est pas aussi merdiques que ça, et alors on veut leur donner des cours de féminisme, leur apprendre à lutter pour leurs droits. Ça c’est des conneries. On n’a rien à leur apprendre malgré tous les livres ou tous les twitts, ou malgré toutes les tables rondes ou rencontres. Et les compañeras, quand on y va ou quand elles viennent, elles viennent pas nous dire ce qu’on a à faire, elles ne nous critiquent pas, elles ne nous regardent pas de travers et ne nous parlent pas mal, comme elles disent. Elles nous parlent en nous disant qu’elles veulent apprendre ! Dis-moi si ça te fais chier, ça. Alors que, nous, on n’a rien à leur apprendre. Elles, elles nous disent, avec leur lutte, leur histoire, que chacune a sa manière de faire. Quand elles nous racontent leurs histoires, elles nous disent : “C’est comme ça qu’on fait nous, mais, bon, à chacune sa manière de faire.” Le plus dingue, c’est qu’avec leur lutte elles nous questionnent, elles nous demandent, nous filent une raclée de celles qu’on apprécie, car elles nous lancent “Et toi, alors ?” qui te secoue de la tête aux pieds que t’en oublierais le syndrome prémenstruel.
Dans mon cas et dans d’autres, ce qui a fait que je me suis rapprochée du zapatisme, ça n’a pas été les compañeras. Ou, plutôt, si, c’est aussi les compañeras zapatistes. Et pas parce qu’on voulait être comme elles. Mais bon, peu importe, les putains de compañeros zapatistes ont aussi quelque chose à voir.
Ce qui se passe c’est que le zapatisme, c’est un truc complètement dingue, car il fait en sorte que tu veuilles être meilleure, mais sans abandonner ce que tu es. Il ne te dit pas d’aller vivre dans une communauté et que tu apprennes sa langue, ni que tu te caches le visage, ni que tu laisses tomber ta famille, ni que t’abandonnes tout et que tu ailles dans la montagne avec les insurgés ou ailleurs. Il te dit et te demande : “Nous, on est là, en train de faire telle chose ici, qu’est-ce que tu fais toi là-bas ?” et le zapatisme ne te fait pas chier avec ces conneries de qu’est-ce que tu es grosse, maigre, grande, petite, basanée, blanche, pouf, éclatée, vieille, jeune, sage, ignorante, paysanne, citadine.
Et crois-moi qu’il n’y a pas d’amour plus dingue que celui-là, qui te respecte, qui t’aime telle que tu es, mais qui t’empoisonne parce qu’en même temps il fait en sorte que tu veuilles être quelqu’un de meilleur, une femme meilleure. On ne te l’exige pas de toi, on ne te le dit pas. Allez, on n’y fait même pas allusion. Et c’est ça qui est très fort, car ces envies naissent de toi-même. Et il n’y a personne à qui réclamer ou à qui rendre des comptes, sauf au putain de miroir. Et on ne peut pas rejeter la faute sur les putains d’hommes ou sur le putain de système ou sur les conditions ou au bordel. C’est vraiment, mais vraiment dingue, parce que tout te tombe dessus, c’est-à-dire qu’on t’oblige à être responsable de cet amour. Il ne te reste même pas un petit coin où te cacher. Enfoiré de zapatisme. »
Moi, comme les machos, j’ai supporté, j’ai pris note, je n’ai rien modifié. Voici les mots tels que je les ai écoutés. Ils sont tels quels, non pas parce que je les ai enregistrés, mais parce que, vous en conviendrez, ce sont des mots difficiles à oublier.
Au final, j’ai dit à la compañera que j‘allais présenter ces mots lors du semis, je lui ai demandé si elle voulait ajouter quelque chose d’autre, « la cerise sur le gâteau », comme on dit. Elle y a réfléchi à peine deux secondes et elle a dit :
« Oui, dis aux putains d’hommes qu’ils aillent niquer leur père, oui leur père, car ce n’est pas de la faute de leur mère s’ils sont aussi cons. Et dis aux compañeras que… que… »
La compañera zapatista qui ne sait pas encore qu’elle est zapatiste ne doute pas, elle semble plutôt chercher un mot qu’elle ne trouve pas.
« Que… que… écoute, je ne suis pas croyante, mais, là, je ne trouve pas d’autre expression pour leur dire ce que je pense. Donc, dis-leur que… que Dieu les bénisse, que je n’espère pas être un jour en face d’elles, mais à leurs côtés, sans sentir la honte me brûler la poitrine. Que j’espère qu’arrivera le jour où, quand elles me diront compañera, c’est parce que je le suis. »
La compañera est partie. Moi, je me suis regardé pour voir si je n’avais pas une quelconque fracture ou hémorragie, si je n’avais pas une blessure, si je n’avais pas perdu autre chose que ma fierté. Voyant que mes magnifiques parties étaient indemnes, je suis allé sur l’ordinateur pour écrire ces mots.
Sup Moy